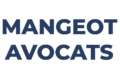Petit rappel pour commencer : dans un arrêt en date du 13 mai 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a consacré le « droit au déréférencement », expression plus pertinente que le « droit à l’oubli ».
Concrètement, la CJUE a procédé en deux temps. Elle a tout d’abord estimé qu’un moteur de recherche de type GOOGLE devait être considéré comme un « traitement de données à caractère personnel » dans le sens où il trouve des informations sur internet, les indexe, les stocke et les met à disposition des internautes.
De ce fait, elle en a tiré la conséquence que ces moteurs de recherche devaient se voir appliquer les dispositions de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Or cette directive prévoit notamment en son article 14 que les personnes faisant l’objet d’un traitement de données à caractère personnel puissent demander la suppression des données les concernant. Il s’agit d’une obligation inscrite depuis longtemps dans notre propre Loi Informatique et Libertés de 1978.
D’où il en ressort le droit pour les internautes de demander aux moteurs de recherche le déréférencement d’informations les concernant sur internet.
Evidemment, ce droit est limité. Il doit s’appuyer sur « des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière ».
Il n’empêche que la CJUE a fait prévaloir ce « droit au déréférencement » sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche et sur le droit à l’information… sauf lorsque la personne faisant l’objet de l’information est une personne publique.
Aussi, suite à cette décision, l’ensemble des moteurs de recherche, et notamment le principal d’entre eux, ont dû créer leur propre procédure de déréférencement.
Or, GOOGLE, après avoir traîné des pieds (ce qui lui a valu une première amende de la CNIL à hauteur de 150 000 euros début 2015), a estimé que l’arrêt de la CJUE ne s’appliquait qu’aux internautes européens… et donc qu’à ses extensions européennes : google.fr, google.de, google.uk… et non à google.com
De son côté, la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) a estimé que « la solution consistant à faire varier le respect des droits des personnes en fonction de l’origine géographique de ceux qui consultent le [site concerné] ne permet pas aux personnes de bénéficier du plein effet de leur droit au déréférencement » et vient donc de condamner le géant américain à une nouvelle amende de 100 000 euros.
Cela suffira-t-il à rendre le droit au référencement véritablement efficace ? On peut en douter lorsque l’on sait que le bénéfice net de GOOGLE était de 14,4 milliards en 2014.
De plus, pour intervenir souvent sur des dossiers d’E-REPUTATION, il s’avère que la procédure mise en place par les moteurs de recherche est loin d’être la plus efficiente. Je conseille à mes clients de faire tout d’abord supprimer le contenu litigieux par l’éditeur du site qui le contient (un courrier d’avocat est souvent dissuasif en la matière) puis de le faire supprimer par les moteurs de recherche via une procédure bien plus simple et rapide que celle du droit à l’oubli.